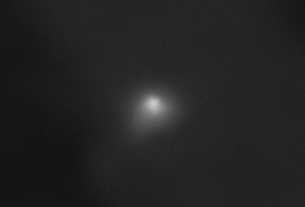Une discipline émergente et des questionnements centraux
La possibilité de faire revivre des espèces éteintes n’est plus présentée comme de la pure science-fiction. Des chercheurs explorent la désextinction, un domaine prometteur mais aussi source de débats sur ses objectifs et ses limites.
Le livre Faire revivre les espèces disparues? de Lionel Cavin et Nadir Alvarez, réédité chez Quanto, examine ces enjeux. Cavin dirige le Muséum d’histoire naturelle de Genève et Alvarez commande le Muséum cantonal des sciences naturelles du canton de Vaud.
Des distinctions essentielles face à l’imagerie hollywoodienne
Les auteurs rappellent que la désextinction ne se déroule pas comme dans les récits inspirés de Jurassic Park. Les avancées actuelles ne visent pas à ramener littéralement des espèces disparues.
À propos du loup sinistre, ils indiquent qu’il s’agit d’un animal modifié à partir du loup gris, avec quelques ajustements ponctuels. Cette approche ne correspond pas à une désextinction au sens strict mais à une forme de chimère vivante.
Des limites techniques et des promesses discutables
Selon Alvarez, les projets qui promettent des retours d’espèces perdues reposent majoritairement sur des modifications génétiques d’animaux encore vivants et ne constituent pas une restauration complète des espèces éteintes. Cette position conduit à remettre en question l’efficacité scientifique de ces démarches.
Pour Cavin, l’ouvrage sert aussi de cadre pour discuter de l’extinction et évaluer dans quelle mesure certaines technologies pourraient, à terme, contribuer à limiter la perte de biodiversité.
Un enjeu largement commercial et ses implications
Un volet central de l’analyse concerne l’aspect économique. Les auteurs estiment que le secteur attirerait des investissements importants, potentiellement mesurables en milliards, et que des espèces emblématiques comme le mammouth servent surtout à capter l’attention du public et des investisseurs.
Selon Alvarez, l’objectif n’est pas de compenser la disparition d’espèces par leur retour, mais de développer des compétences en génétique susceptibles d’avoir des applications dans d’autres domaines, notamment l’agronomie et la médecine. Le véritable plan serait de diversifier les marchés plutôt que de chercher à ressusciter des mammouths.
Les auteurs soulignent néanmoins que toute recherche s’inscrit dans un cadre éthique et réglementaire, et qu’un décalage persiste entre les annonces publiques et les effets concrets.
Ils dénoncent aussi les propos politiques qui présentent la désextinction comme une solution miracle à la perte de biodiversité, estimant ces idées discutables. L’ouvrage appelle à une réflexion nuancée sur les usages potentiels des techniques génétiques et leurs limites.