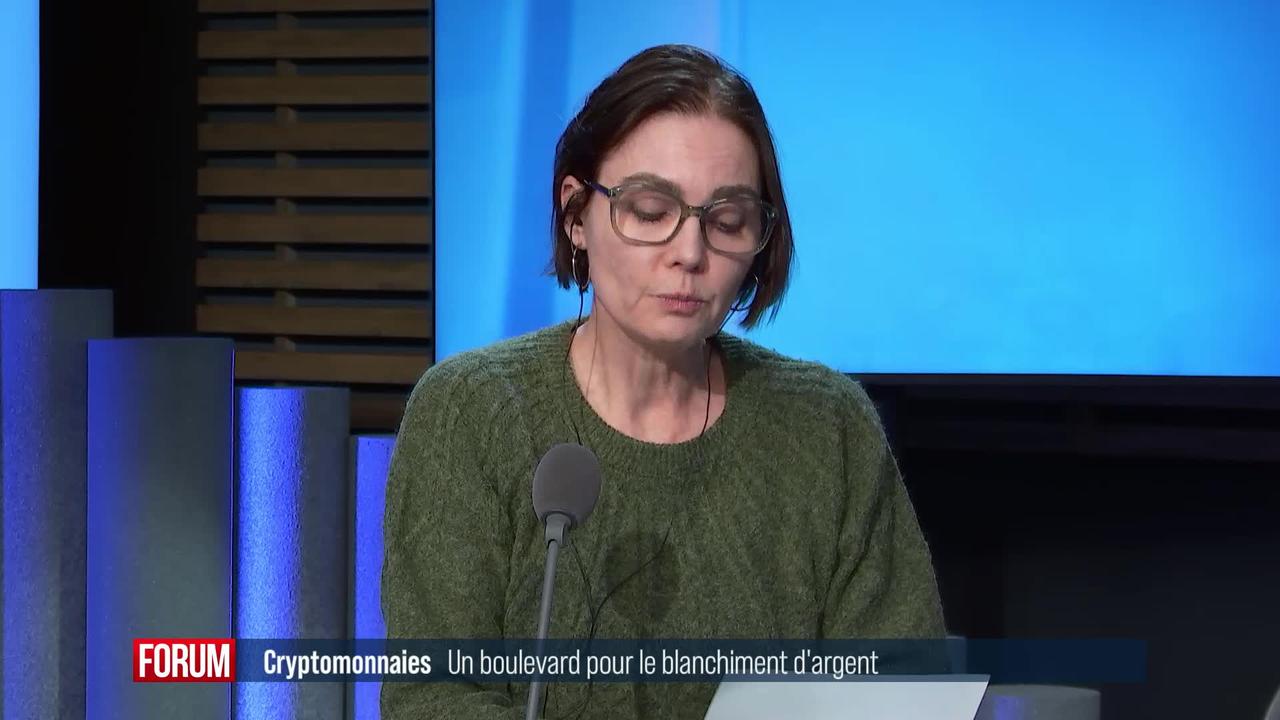Genèse du récit et contexte historique
Au début du XXe siècle, Gilberte Montavon, serveuse à l’hôtel de la gare de Courgenay, est associée au moral des mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Son rôle est présenté dans une Suisse miniature, tiraillée entre Romands francophiles et Alémaniques fidèles au Kaiser, comme un symbole de cohésion nationale malgré les tensions。
De la chanson populaire au film et à la légende
La figure de Gilberte devient d’abord une chanson populaire puis une pièce de théâtre écrite par le Bâlois Rudolf Bolo Mäglin, avant d’alimenter un roman. Le réalisateur bernois Franz Schnyder réalise ensuite un film qui contribue à forger le mythe, décrit comme celle que l’on connaît dans toute la Suisse et dans l’armée. Dans l’adaptation cinématographique, Gilberte passe du brun au blond et est incarnée par la comédienne bilingue Anne-Marie Blanc. Nous sommes en 1941 et ce personnage participe à renforcer le moral et le patriotisme du pays.
Une réinterprétation germanophone et une approche dramaturgique contemporaine
Pour sa première mise en scène en langue allemande, à Zurich, le metteur en scène Mathieu Bertholet, ancien directeur du Théâtre Le Poche à Genève, convoque Gilberte. « Une schnnapsidée », résume-t-il, une blague de fin de soirée qui s’avère néanmoins sérieuse et concrète. Gilberte, c’est un peu moi, affirme le créateur bilingue, qui partage la mission de rapprocher les publics romand et alémanique.
Un cabaret bilingue et satirique
Éléments scéniques et esthétiques
Sur la scène du Neumarkt, l’héroïne s’impose dès l’entame par un numéro chorégraphique et cabaret. La troupe déplace tables et chaises d’un café, agrémentant le décor de tubes d’Aromat et de fioles de Maggi, avant d’endosser les lourdes vareuses des conscrits avec des regards amoureux. Le registre érotique et ludique demeure présent, avec des clins d’œil au cabaret de Weimar, où l’on chante « Sentiers valaisans », clin d’œil aux origines du nouvel intendant du théâtre.
Réflexion identitaire et palette linguistique
Cette interprétation s’inscrit dans un esprit comparable à celui de Christoph Marthaler, grand nom du théâtre zurichois qui mêle musique, satire et symboles helvétiques. Le spectacle cite régulièrement le film de Schnyder et alterne les langues, avec des passages sous-titrés pour le public. Il interroge l’identité suisse, la crainte de l’étranger, le surtourisme et l’influence des fortunes qui s’installent au bord des lacs, parfois avec une pointe d’ironie.
Le destin de Gilberte sur scène et à l’écran
Tel que dans l’histoire originale, Gilberte renonce à son amour pour Hasler, fiancé à Tilly, bourgeoise bernoise protégée par son père. Sur scène, la figure est portée par la troupe, qui fait évoluer le personnage à travers les costumes et les registres, menant à un final collectif où l’héroïne semble pacifier les langues autant que les genres.
Informations pratiques et prolongation
La pièce Gilberte de Courgenay de Mathieu Bertholet est présentée au Theater Neumarkt, à Zurich, et se prolonge jusqu’au 17 janvier 2026.